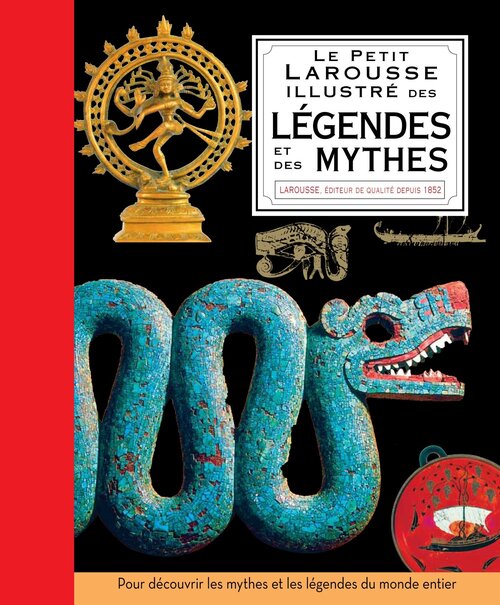Temps de lecture : 13 minutes
Qui sont ces saintes Maries de la Mer que l’on trouve en Provence ?… C’est une histoire très belle, si belle que les vagues caressantes — pour l’écouter, couraient le long du rivage, — à troupeaux.
À la conquête des âmes
Ces saintes Maries, ce sont les amies du Christ, ces saintes femmes qui le suivaient, au long des chemins de Palestine, alors qu’il allait, annonçant « la bonne nouvelle ».
 Les Trois Maries : Marie-Jacobé, sœur de la Vierge ; Marie-Salomé, mère de Jacques et Jean, les apôtres au cœur ardent et Marie de Magdala, la Madeleine, sœur de Marthe et Lazare, celle que Jésus avait guérie de ses péchés et qui, fidèle, jusqu’au bout l’accompagna de son amour. Avec elles, Marthe, la bonne maîtresse de maison, et Sara, la servante au brun visage.
Les Trois Maries : Marie-Jacobé, sœur de la Vierge ; Marie-Salomé, mère de Jacques et Jean, les apôtres au cœur ardent et Marie de Magdala, la Madeleine, sœur de Marthe et Lazare, celle que Jésus avait guérie de ses péchés et qui, fidèle, jusqu’au bout l’accompagna de son amour. Avec elles, Marthe, la bonne maîtresse de maison, et Sara, la servante au brun visage.
Les Juifs, qui avaient fait mourir le Sauveur, fermant au message divin leurs oreilles et leur cœur, maltraitaient ses amis. Ils chassèrent de leur pays les saintes femmes, les jetant dans une barque sans gouvernail, sans voiles ni rames. Ils embarquèrent en même temps Lazare, le ressuscité, Maximin l’évêque et le saint vieillard Trophime, témoins gênants du Christ.
Sur la mer bleue, qui baigna les pieds de Jésus, au rivage de Palestine, vogue la barque au caprice des flots. Une vague la lance à l’autre vague, comme un jouet. Jours gris sous un ciel tourmenté de nuages, nuits interminables où ne sourit aucune étoile. La tempête fait rage : tantôt au fond d’un gouffre plonge la barque ruisselante d’embruns ; tantôt, comme un fétu de paille, une trombe d’eau la soulève et, transis et tremblants, les pauvres voyageurs lèvent leurs regards suppliants vers le Ciel.
Les saintes prient, confiantes… tout dre e li man juncho « toutes droites et les mains jointes ». Invisibles, les Anges guident la barque… Vers les côtes de Provence, pour en faire don au beau pays qui sera la France, tout doucement, ils la poussent… Sur le rivage désert, les exilés abordent à la plage de sable fin.
À genoux, les amis du Christ remercient le Seigneur. Ils baisent cette terre qui les accueille et, pleins de zèle, les voilà qui partent à la conquête des âmes.
Lazare, dans Marseille, la riche et orgueilleuse cité, porte le message du Christ, ami des pauvres et des humbles et Marseille pleure ses péchés.
La Sainte Baume
Où va celle-ci, les yeux baissés sous son voile qui dérobe aux regards l’éclat de sa chevelure d’or, si belle que, pour la voir passer, les vieux pins se font signe.
Par les landes pierreuses, les vignobles et les olivettes, par delà les montagnettes peuplées de pins odorants, elle va… Longtemps, longtemps elle marche sur les pas d’un guide invisible à nos yeux. C’est Marie-Madeleine, Marie la contemplative, que Dieu appelle dans la solitude…
La noire montagne des Maures court le long de la mer ; une autre chaîne, plus élevée, par le même chemin, s’en va vers Marseille. Sur la plus haute montagne, Madeleine suit l’appel divin. Et voici que s’ouvre devant elle une vaste forêt qui laisse dans l’étonnement, tant elle est différente des paysages du Midi. Plus de pins ni d’eucalyptus, plus d’orangers ni de chênes-liège, mais de hautes fûtaies de hêtres et de chênes que jamais ne profane la hache du bûcheron. Quel silence, quelle solitude dans ses- profondeurs ! Tout en haut, parmi les rochers sauvages, une grotte béante, comme suspendue au-dessus de l’abîme. Sans hésiter, Marie-Madeleine pénètre dans l’ouverture de rochers. C’est là la demeure que le Seigneur lui a choisie : la sainte Baume 1.
Dans la sainte Baume, Madeleine prie. Ses genoux et ses coudes se meurtrissent sur la pierre. Et la lune la veille avec son flambeau pâle. Autour d’elle, la forêt se tait, recueillie, et les petits oiseaux, sur la montagne du Saint-Pilon, soudain ont fait silence. Tout alentour se penchent les Anges. Lorsqu’un pleur de Madeleine tombe sur la pierre, telle une perle précieuse, vite ils le recueillent dans leur calice d’or. Et de ces larmes bénies jaillit la source vive de l’Huveaune qui doucement descend dans la vallée baigner le pied des oliviers.
Madeleine pleure, prie et contemple… Chaque jour, les mêmes scènes revivent en son esprit, tandis qu’elle repasse dans son cœur les paroles divines que le Maître prononça pour elle seule et que l’Évangile garde comme un trésor.
Elle se revoit, jeune et belle, courant au plaisir, parant son front de couronnes fleuries, tandis que de son âme souillée se détournent les Anges. Elle sent encore, posé sur elle, le regard du Maître qui, pénétrant jusqu’au fond de son être, comme un trait de feu, lui dévoile tout d’un coup l’abîme de sa misère. Tandis qu’elle baigne les pieds du Seigneur de ses larmes et de ses parfums, elle entend la voix grave et suave : « Beaucoup de péchés lui sont pardonnés… »
Les trois années lumineuses à la suite du Maître… La soirée de Béthanie, Marthe, s’empressant, affairée, aux soins du ménage ; elle, assise aux pieds du Seigneur, buvant ses paroles. La plainte de cette pauvre Marthe, toujours soucieuse : « Dites-lui donc de m’aider. » Et la parole du Maître, qu’elle croit entendre encore : « Marie a choisi la meilleure part… »
La seconde scène du parfum, le vase brisé, les murmures des apôtres — qui n’ont pas compris — et le reproche si doux du Sauveur : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? »
La douloureuse journée après la terrible nuit de la trahison, le calvaire, les clous, la croix, les injures des prêtres et du peuple aveuglé, les brutalités des soldats romains… Le cri terrible du Crucifié, le coup de lance du Centurion… Marie entend, Marie voit tout cela dans sa contemplation. Et ce matin radieux de la Résurrection… Sa peine, son angoisse devant le Tombeau vide, sa recherche anxieuse et tout à coup, la voix qui la bouleverse : Marie. Ce matin de Pâques, où elle, pécheresse, la première voit de ses yeux le Christ ressuscité.
Ravie de joie et d’amour, Madeleine, portée par les Anges au sommet du Saint-Pilon, goûte les harmonies célestes et voit s’ouvrir le Paradis.Mais chaque jour, dans la grotte obscure, se meurtrissent ses genoux et coulent, intarissables, ses larmes.
Mais voici qu’elle entend l’appel du Seigneur. Elle va quitter la terre. Les Anges la transportent à l’oratoire de l’évêque Maximin qui lui donne le pain eucharistique. Dans un paisible sommeil, l’âme de Madeleine purifiée quitte la frêle enveloppe de son corps.
Ce corps vénéré, Maximin le couche dans un cercueil d’albâtre. De siècle en siècle il est parvenu jusqu’à nous. L’église de Saint-Maximin, achevée par le roi René, précieusement le garde dans sa crypte où vinrent s’agenouiller, au fil de l’histoire, les papes et les rois : Louis XII, Charles VIII, Anne de Bretagne, François Ier, Louis XIII et le grand Louis XIV, tous humbles pèlerins de la Sainte-Baume. Tandis que, dans la grotte bénie, témoin d’un si profond repentir et d’un si merveilleux amour, d’autres pèlerins cherchent les traces de Madeleine et, dans le silence, sont à l’écoute des secrets divins.
lire encore plus : https://www.maintenantunehistoire.fr/les-saintes-maries-de-la-mer/








































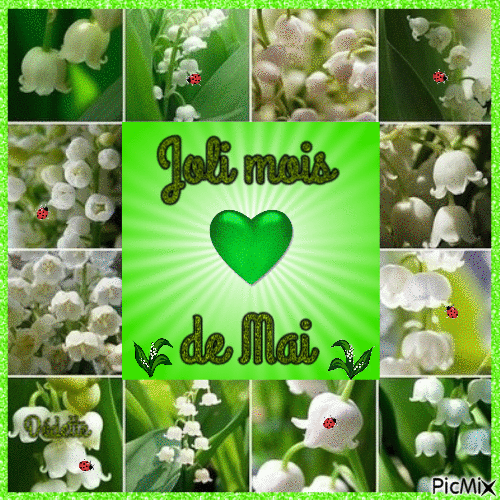











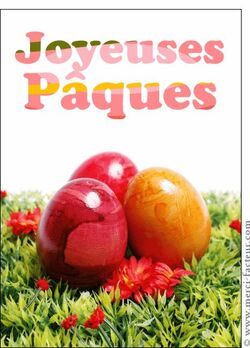















































































































































































































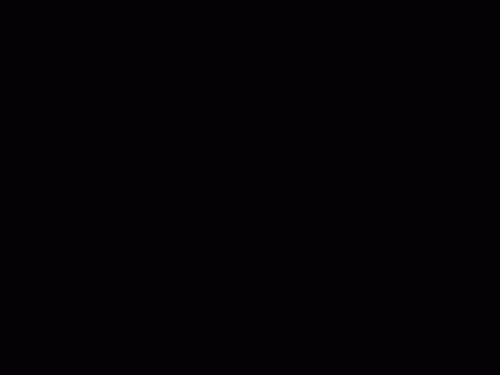







































































































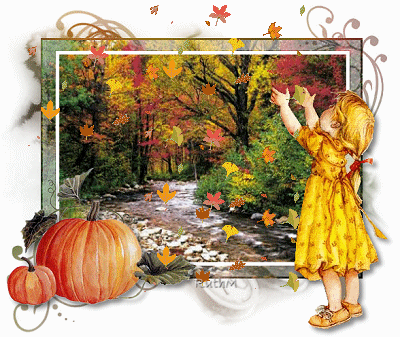


























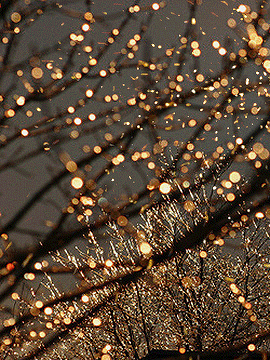
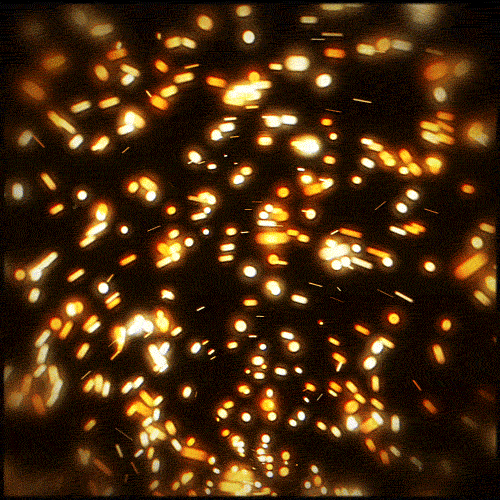


















 Crédits
Crédits  Crédits
Crédits  Crédits
Crédits